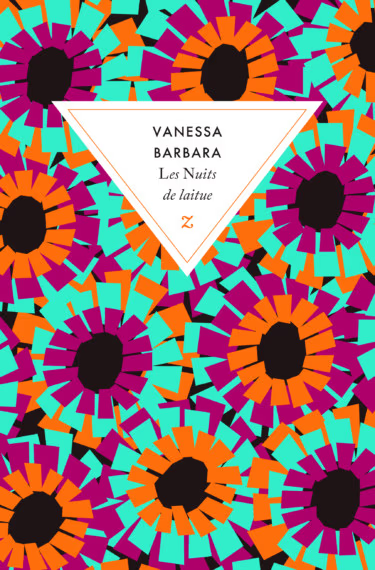Traduction de l’allemand par Dominique Petit et Françoise Toraille – Éditions Philippe Picquier
Le challenge des gravillons proposé par Sibylline était l’occasion idéale pour sortir de ma PAL ce court roman qui y dort depuis près de 3 ans !

Entre deux polars, je m’attendais à ce qu’il m’offre une grande bouffée d’air frais et un dépaysement bienvenu. Alors, certes, on est sous une yourte mongole, mais l’histoire qui nous est racontée est en quelque sorte « #metoo dans la steppe » (et avant l’heure puisque le roman a paru pour la 1re fois en 2001). Le propos est donc d’une actualité frappante (masculinisme quant tu nous tiens) et pas léger-léger.

Galsan Tschinag est un auteur mongol, et plus précisément touvain (les Touva sont un peuple turcique de Mongolie), qui a vécu en Allemagne, y a étudié et écrit en langues mongole et allemande. Il sait de quoi il parle et n’idéalise pas la vie nomade, sans la rejeter. Dans ce roman, il montre surtout les mâles sous leur jour le plus rustre, pour ne pas dire animal. La pauvre Dojnaa est ainsi mariée à Doormak, que je qualifierai de sale type, pour le moins :
« Une fois de plus, il avait le sentiment qu’elle l’agressait, que son statut de mari était menacé, prêt à s’effondrer et à sombrer dans le ridicule. Il crut qu’il lui fallait se défendre, ce qu’il fit sur-le-champ : il lui flanqua une gifle retentissante. (…) Il éprouvait la même chose qu’un chien qui a terrassé un loup plus par inadvertance que volontairement. Et tout comme le chien, il n’avait pas de plus cher désir que de recommencer à la première occasion. »
Longtemps, Dojnaa accepte de « rester à sa place », par respect des traditions, parfois par pitié pour ce mari si puéril, et surtout par dépendance affective et matérielle (un scénario bien connu des violences conjugales). Et puis, un jour, Doormak s’en va et, cette fois, ne revient pas. Dojnaa va alors renouer avec sa vraie nature, celle d’une chasseuse, d’une force de la nature, le roman prenant alors un tour initiatique, presque mystique.
Je m’attendais à un roman un peu contemplatif, avec force descriptions de la nature et faisant de Dojnaa une « femme forte » luttant contre l’adversité. Or, c’est bien plus dynamique, subtil et complexe que ça. Galsan Tschinag est un auteur à découvrir, à la langue parfaitement accessible et délicate. Je reviendrai certainement vers son œuvre, d’autant que j’ai repéré La fin du chant chez Cath L.